Quels sont les effets du stress chronique ?
Le stress est connu depuis longtemps… Cependant, c’est Hans Selye, un médecin hongrois qui, en 1936, le décrit dans sa définition moderne comme un syndrome général d’adaptation. Même s’il n’est pas une maladie, le stress peut altérer notre bien-être et notre santé quand il dure dans le temps et devient chronique.
Qu’est-ce que le stress ?
Le stress est une réaction naturelle d’adaptation de l’organisme face à un danger, une situation d’agression physique ou psychique (stresseur). Il nous permet d’assurer notre survie. Ce phénomène physiologique est sain, adapté et commun à tous les êtres vivants.
Phase 1 : la phase d’alarme
Lors d’un stress aigu, l’organisme se met en alerte. Les aptitudes physiques et intellectuelles sont décuplées pour pouvoir réagir rapidement et assurer la survie. L’organisme en situation de stress sécrète des hormones (adrénaline, noreadrénaline) qui augmentent le rythme cardiaque, la pression artérielle, la respiration, les niveaux de vigilance, le tonus musculaire, baissent l’activité digestive…

Phase 2 : la phase d’adaptation ou de résistance
La phase d’adaptation conduit l’organisme à produire du cortisol, aussi appelée l’hormone de stress, pour s’adapter et faire revenir à la normale toutes ses fonctions.
Mais si la source de stress persiste, l’organisme entre en résistance. Les ressources du corps sont encore mobilisées. De nouveaux changements physiologiques préparent le corps à gérer la situation à plus long terme. Cette autorégulation maintient un équilibre fragile entre mobiliser les ressources nécessaires pour faire face et préserver l’intégrité de l’organisme.
Chez l’être humain dont la capacité d’adaptation est grande, cette phase est dangereuse peut conduire à la phase d’épuisement.
Phase 3 : la phase d’épuisement
À ce stade, les capacités de l’organisme sont dépassées et les ressources mobilisées pour faire face au stress chronique s’épuisent. Les tentatives d’adaptation sont inefficaces. L’organisme est submergé. Des difficultés de santé apparaissent alors.
Qu’est-ce que le stress chronique ?
Le stress devient chronique (on parle alors de mauvais stress) lorsqu’il s’inscrit dans le temps. Les situations stressantes se prolongent sur plusieurs semaines, mois ou mêmes années. Notre corps sécrète alors en continue du cortisol, l’hormone sensée permettre à l’organisme de revenir à la normale. Mais sur la durée, elle a des effets négatifs sur la santé physique et la santé mentale (phases de résistance et d’épuisement).
Quels sont les effets du stress chronique ?
Le stress chronique provoque de nombreux symptômes variables selon les personnes et les situations. Ils sont autant physiques que psychologiques.
Le bien-être mental et le sommeil
Avant d’impacter le corps, le stress chronique perturbe le bien-être mental et le sommeil.
Ainsi, la fatigue, l’anxiété, l’irritabilité, l’hyperémotivité, les insomnies, les réveils nocturnes, la perte de motivation au quotidien peuvent être les premiers symptômes en réponse au stress chronique. Et à plus long terme, il favorise les troubles anxieux et l’apparition d’une dépression.
Une perturbation du système immunitaire
Le stress chronique affaiblit aussi le système immunitaire. En effet, plus on est stressé, plus notre cortisol est élevé, et moins nous sommes en mesure de faire face à des pathogènes. On tombe plus souvent malade, et de façon plus sévère.
Des maladies chroniques
L’élévation du taux de cortisol généré par l’état de stress permanent finit par déréguler l’équilibre de l’organisme et il peut alors apparaître :
- Une résistance à l’insuline pouvant aller jusqu’à un diabète de type 2,
- Des maladies cardio-vasculaires, de l’hypertension artérielle,
- Des ulcères à l’estomac,
- Des maladies de peau réactionnelles : eczéma, acné, psoriasis,
- Des migraines,
- Un burn-out
- Etc.

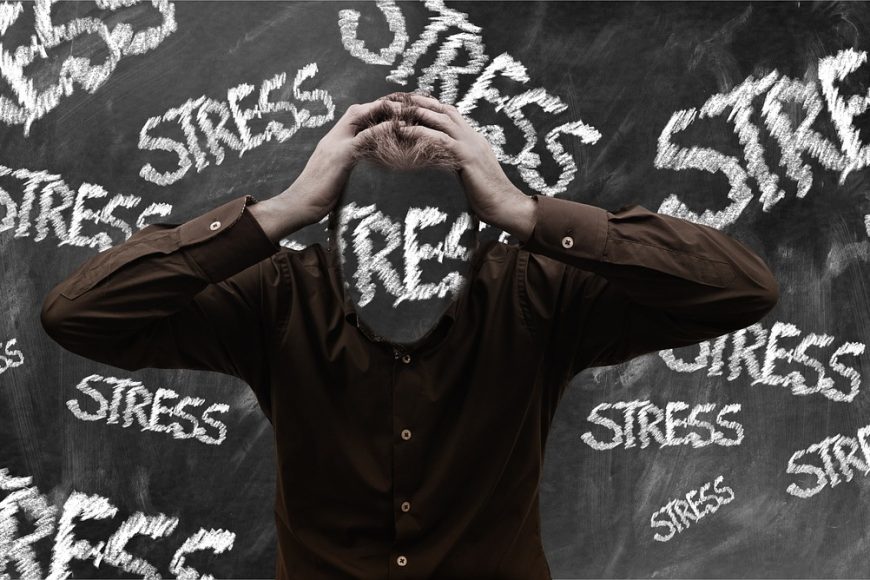
[…] A LIRE AUSSI : Quels sont les effets du stress chronique ? […]
[…] Quels sont les effets du stress chronique […]